FERNANDO SOR - PHILIPPE MOURATOGLOU
Lorsque Fernando Sor voit le jour à Barcelone, en 1778, la guitare est en train de vivre sa plus profonde mutation organologique depuis pas loin de deux siècles : alors que l’instrument baroque se distinguait par ses cinq cordes doubles (sauf la chanterelle) et son accord dit ré-entrant (la corde la plus grave n’étant pas la cinquième, mais la quatrième, voire la troisième selon le choix de cordes à l’octave ou à l’unisson), la guitare de la fin du XVIIIème siècle perd ses cordes doubles mais gagne une corde de plus dans le registre grave. L’époque, il faut le dire, est aux Lumières, à la défiance vis-à-vis des vieilles coutumes et de l’ancien régime. La guitare baroque, qui a brillé de ses derniers feux depuis déjà longtemps, est emportée par ce flux révolutionnaire qui engloutira également le luth puis le clavecin. La notation en tablature, qui avait jusque-là assuré son succès auprès des amateurs, est désormais jugée désuète et complexe. En bref, dans les années où le jeune Fernando se forme à la musique dans le cadre sévère de l’abbaye de Montserrat, la guitare est redevenue cet attribut des rues et de la plèbe qu’elle était avant que Louis XIV n’en fasse un signe de distinction « noble », prisé de l’aristocratie. Et c’est presque clandestinement qu’il s’y adonne car si on lui reconnaît un talent précoce —son premier opéra, Telemacco, est créé avec succès en 1797 — on comprend moins son penchant pour un instrument jugé fruste et réservé à l’usage des classes dangereuses.
Il faut avoir présent à l’esprit ce contexte pour comprendre en quoi l’oeuvre de Sor, si souvent réduite à la caricature d’une musique « de salon », est avant tout le fruit d’une obstination solitaire et d’une force d’esprit qui distingue les artistes en lutte contre les préjugés de leur temps. Même si, parfois, les événements décident pour eux : c’est ainsi que Sor, qui évolue dans des milieux favorables à Napoléon, doit se résoudre à quitter l’Espagne sans retour lorsque les troupes napoléoniennes sont défaites en juin 1813 après la bataille de Victoria. Et c’est donc naturellement qu’il s’installe à Paris, où la guitare connaît un tel engouement qu’on lui inventera bientôt le terme de « guitaromanie ». Prise d’une fièvre romantique, la ville-lumière attire alors quantité de musiciens venus de partout, et les guitaristes ne sont pas les derniers à y tenter leur chance, puisque s’y retrouvent également Ferdinando Carulli, Francesco Molino, Dionisio Aguado, entre autres. De cette riche émulation, qui pouvait passer par toutes les nuances de la sociabilité, l’amitié admirative le disputant à la rivalité aigre, est né le corpus majeur de la guitare dite « classique », guitare dont le luthier Antonio de Torres fixera la forme canonique que nous lui connaissons aujourd’hui vers 1850. Ce répertoire, avant tout dominé par le souci de plaire, faisait une large place à la variation sur des airs d’opéra, et ne se souciait guère de développer les possibilités techniques de l’instrument, encore moins de faire avancer en quoi que ce soit le langage musical. Il nous en reste des pages charmantes, de Carulli, Carcassi ou Giuliani, mais rien qui ne puisse se comparer aux chefs-d’oeuvre des phares du piano de la même période. Cet état de fait a contribué à faire de la guitare classique un petit monde à part, longtemps toisé avec quelque condescendance par les mélomanes comme par les musicologues. Et il n’est pas sûr que les efforts entrepris par Andrès Segovia au XXème siècle pour imposer la guitare comme un instrument « sérieux » aient totalement dissipé cette mauvaise réputation ; le sérieux marmoréen de Segovia ayant au contraire figé l’instrument et son répertoire dans un conservatisme légèrement obsidional qui n’a desserré son carcan que depuis sa disparition.
La guitare pré-romantique aurait donc peu à faire valoir dans l’histoire de la musique si ne s’était trouvé, pour la servir et l’honorer, un homme tout à fait à part comme Fernando Sor. Car il n’est point besoin d’être un spécialiste de ce répertoire pour entendre immédiatement, même dans ses oeuvres les plus modestes, l’expression d’une puissante originalité. Certes, Fernando Sor ne dédaigna ni les succès ni les honneurs et accepta les circonstances (il connût encore les joies et les peines de l’exil, à Londres, puis en Russie avant son retour à Paris en 1826), mais une chose le distingue de ses contemporains : le refus de la facilité. Refus plus éthique que technique, en l’espèce, puisque beaucoup de ses oeuvres pédagogiques, sans être particulièrement difficiles à jouer, ménagent presque toujours un élément de surprise, une modulation, un tour de phrase inattendus. Philippe Mouratoglou fait observer avec raison que ces trouvailles précieuses se rencontrent curieusement plus dans ses Etudes que dans les « grandes » oeuvres de concert « dans lesquelles se côtoient des passages très inspirés et des choses nettement plus conventionnelles ». Cela ne doit guère étonner de la part d’un homme qui a mis le meilleur de lui-même dans la transmission et dont les pièces didactiques, loin de constituer une activité annexe, furent une raison d’être.
Comme tout grand maître, Sor apprend en enseignant. Le propos technique qu’il veut illustrer par telle étude ou telle leçon se dissout dans l’évidence de la musicalité, et s’efface poliment derrière la primauté du chant. Même s’il n’a pas produit une grande quantité de musique vocale, on sait que Sor fut obsédé toute sa vie par le bel canto, passion que partagea également un instrumentiste-compositeur contemporain autrement célèbre, Frédéric Chopin. Eu égard à cette religion du chant comme modèle absolu d’esthétique instrumentale, il n’est pas exagéré de dire que les études de Sor, du moins les plus belles, sont à la guitare ce que celles de Chopin sont au piano : un postulat technique pour oublier la technique. Cette passion de la ligne vocale, lorsqu’elle est assouvie avec autant d’ardeur que chez Chopin ou Sor, offre à la structure harmonique une liberté nouvelle et c’est alors avec un naturel confondant que les modulations les plus hardies peuvent sonner avec la clarté lustrale des évidences. Sans aller aussi loin que Chopin dans le jeu qu’autorise l’enharmonie, Sor se distingue par sa faculté d’éclairer une même cellule mélodique par des harmonies différentes, ou de traiter une même mélodie successivement dans le mode majeur puis mineur. Evidemment, le goût du bel canto régnait alors en maître chez tous les musiciens et mélomanes mais Bernard Piris rappelle avec raison, dans sa précieuse monographie consacrée à Sor, en quoi cette passion de la vocalité a pu, aussi, stériliser l’inspiration des moins bons artistes et stimuler les meilleurs : « les mélodies italiennes sont, il est vrai, souvent belles et au moins séduisantes lorsqu’elles ne sont qu’habiles, et rendent le jeu de la guitare assez violonistique dans ses effets, mais il semble que cette exclusive du chant a pour inconvénient majeur de faire adapter la technique de composition aux contingences, aux idiomatismes de l’instrument. Giuliani, qui a laissé nombre de petites pièces et d’études ravissantes, équilibrées et très fines, qui est un grand mélodiste (…) ne donne qu’une oeuvre longue et ennuyeuse, d’un conventionnel tout en « ficelles » quand il écrit par exemple sa Grande Ouverture op. 61. (…) Sor, au contraire, s’accommode très bien d’un motif de notes répétées, qui serait insignifiant s’il n’était habillé d’une harmonie, ou valorisé par un contrepoint dont les secrets, alors, n’appartiennent qu’à lui. _ » Fernando Sor fut donc un homme de son temps 1 mais aussi, comme pour tous les artistes dont l’oeuvre traverse les époques, un marginal obstiné qui a préféré les redoutables plaisirs de la solitude aux peines du conformisme, fussent-elles plus immédiatement séduisantes pour ses confrères moins regardants. D’ailleurs, Sor n’a que peu cédé à la vogue du thème varié sur des airs d’opéra, à l’exception notable de son Opus 9, les Variations sur « O Cara Armonia » de Mozart, qui résument déjà toute son ingéniosité et témoignent d’une fascination si durable pour la Flûte enchantée qu’on a cru y voir l’indice probant d’une adhésion de Sor aux idéaux de la franc-maçonnerie qui ralliait alors bon nombre de ses pairs musiciens. Au-delà de ce point d’histoire, ces six pages, pas si primesautières qu’elles en ont l’air, concentrent tout le talent de leur auteur pour soumettre le prétexte technique au magistère de l’expressivité.
C’est la même exigence qui a guidé Philippe Mouratoglou dans la sélection des pièces qui composent ce programme : « Le choix du répertoire de ce disque ne résulte pas d'une volonté de "dénicher" des pièces peu jouées ou autres "chefs d'oeuvre inconnus" de Sor, mais plutôt de proposer une sélection de mes pièces favorites (qui sont d'ailleurs toutes — à l'exception du "Calme" — des oeuvres de jeunesse) et d'en pousser l'interprétation le plus loin possible. Mes références en la matière ne sont par ailleurs pas les guitaristes classiques "historiques" mais bien d'avantage des pianistes comme Sviatoslav Richter, Martha Argerich, Arturo Benedetti Michelangeli, Claudio Arrau… (même si j'apprécie dans Sor des interprètes comme Andres Segovia ou Roland Dyens - probablement d'avantage pour la singularité de leur empreinte sonore que pour des raisons purement interprétatives) ».
Pareillement, le choix d’interpréter ces oeuvres sur un instrument moderne, et non sur une guitare romantique, se justifie pleinement par la richesse de nuances et de résonances qu’il sait en tirer. Dans ses précieuses Histoires de peintures, Daniel Arasse notait que l’historien d’art ne doit pas craindre d’être anachronique, puisque l’art est toujours contemporain pour le contemporain qui le regarde_ 2. Il en va de même pour l’interprète qui, sans mésestimer les mérites d’une interprétation « historiquement informée » et le charme puissant des instruments d’époque, choisit néanmoins de jouer Fernando Sor, Benjamin Britten ou Toru Takemitsu sur le même instrument : l’enjeu est alors de savoir leur prêter des couleurs sonores, des articulations, des dynamiques différentes, toutes choses que permet la lutherie moderne, si tant est qu’elle soit au service d’une compréhension intime des musiques de chaque époque. L’omnipotent critique Fétis, qui multiplia les éloges doux-amers de Sor tout en regrettant que celui-ci s’exprime sur un instrument aussi ingrat et peu sonore que la guitare de son temps_3, rabattrait assurément son caquet en découvrant comment cette musique peut sonner sur un instrument moderne, joué par un interprète qui sait en exprimer les rémanences et la plénitude harmonique, en utilisant toute la palette de résonances qu’offre la technique moderne, y compris en matière de prise de son.
Car chez Fernando Sor, le silence importe autant que les notes : le détaché stroboscopique — mais pas sec, ni pizzicato!— de l’Etude op.31 n°20, la carrure ïambique de l’Etude op.35 n°17, si facile à ruiner en ignorant les demi-soupirs qui lui donnent sa prestance et son allant, ou les discrètes mais néanmoins indispensables respirations de la tumultueuse Etude op.6 n°9 toute baignée de son impérieux ré grave qui ne doit pas la noyer, sont autant de détails qui échappent souvent aux amateurs attirés par l’apparente facilité digitale de ces pages certes bienveillantes, mais certainement pas faciles.
Sa musique en surface séduisante et familière ressemble finalement à l’un des rares portraits qu’il nous reste de son auteur : il est saisi avec cette sorte de demi-sourire qui dit l’ironie sans méchanceté, le retrait engagé et la ferveur sans illusion de tous les artistes qui ont préféré, à leur corps pas trop défendant, la justesse à la grandeur. Et qui nous parlent encore, en proportion de cette folle sagesse.
Gilles Tordjman
Lorsque Fernando Sor voit le jour à Barcelone, en 1778, la guitare est en train de vivre sa plus profonde mutation organologique depuis pas loin de deux siècles : alors que l’instrument baroque se distinguait par ses cinq cordes doubles (sauf la chanterelle) et son accord dit ré-entrant (la corde la plus grave n’étant pas la cinquième, mais la quatrième, voire la troisième selon le choix de cordes à l’octave ou à l’unisson), la guitare de la fin du XVIIIème siècle perd ses cordes doubles mais gagne une corde de plus dans le registre grave. L’époque, il faut le dire, est aux Lumières, à la défiance vis-à-vis des vieilles coutumes et de l’ancien régime. La guitare baroque, qui a brillé de ses derniers feux depuis déjà longtemps, est emportée par ce flux révolutionnaire qui engloutira également le luth puis le clavecin. La notation en tablature, qui avait jusque-là assuré son succès auprès des amateurs, est désormais jugée désuète et complexe. En bref, dans les années où le jeune Fernando se forme à la musique dans le cadre sévère de l’abbaye de Montserrat, la guitare est redevenue cet attribut des rues et de la plèbe qu’elle était avant que Louis XIV n’en fasse un signe de distinction « noble », prisé de l’aristocratie. Et c’est presque clandestinement qu’il s’y adonne car si on lui reconnaît un talent précoce —son premier opéra, Telemacco, est créé avec succès en 1797 — on comprend moins son penchant pour un instrument jugé fruste et réservé à l’usage des classes dangereuses.
Il faut avoir présent à l’esprit ce contexte pour comprendre en quoi l’oeuvre de Sor, si souvent réduite à la caricature d’une musique « de salon », est avant tout le fruit d’une obstination solitaire et d’une force d’esprit qui distingue les artistes en lutte contre les préjugés de leur temps. Même si, parfois, les événements décident pour eux : c’est ainsi que Sor, qui évolue dans des milieux favorables à Napoléon, doit se résoudre à quitter l’Espagne sans retour lorsque les troupes napoléoniennes sont défaites en juin 1813 après la bataille de Victoria. Et c’est donc naturellement qu’il s’installe à Paris, où la guitare connaît un tel engouement qu’on lui inventera bientôt le terme de « guitaromanie ». Prise d’une fièvre romantique, la ville-lumière attire alors quantité de musiciens venus de partout, et les guitaristes ne sont pas les derniers à y tenter leur chance, puisque s’y retrouvent également Ferdinando Carulli, Francesco Molino, Dionisio Aguado, entre autres. De cette riche émulation, qui pouvait passer par toutes les nuances de la sociabilité, l’amitié admirative le disputant à la rivalité aigre, est né le corpus majeur de la guitare dite « classique », guitare dont le luthier Antonio de Torres fixera la forme canonique que nous lui connaissons aujourd’hui vers 1850. Ce répertoire, avant tout dominé par le souci de plaire, faisait une large place à la variation sur des airs d’opéra, et ne se souciait guère de développer les possibilités techniques de l’instrument, encore moins de faire avancer en quoi que ce soit le langage musical. Il nous en reste des pages charmantes, de Carulli, Carcassi ou Giuliani, mais rien qui ne puisse se comparer aux chefs-d’oeuvre des phares du piano de la même période. Cet état de fait a contribué à faire de la guitare classique un petit monde à part, longtemps toisé avec quelque condescendance par les mélomanes comme par les musicologues. Et il n’est pas sûr que les efforts entrepris par Andrès Segovia au XXème siècle pour imposer la guitare comme un instrument « sérieux » aient totalement dissipé cette mauvaise réputation ; le sérieux marmoréen de Segovia ayant au contraire figé l’instrument et son répertoire dans un conservatisme légèrement obsidional qui n’a desserré son carcan que depuis sa disparition.
La guitare pré-romantique aurait donc peu à faire valoir dans l’histoire de la musique si ne s’était trouvé, pour la servir et l’honorer, un homme tout à fait à part comme Fernando Sor. Car il n’est point besoin d’être un spécialiste de ce répertoire pour entendre immédiatement, même dans ses oeuvres les plus modestes, l’expression d’une puissante originalité. Certes, Fernando Sor ne dédaigna ni les succès ni les honneurs et accepta les circonstances (il connût encore les joies et les peines de l’exil, à Londres, puis en Russie avant son retour à Paris en 1826), mais une chose le distingue de ses contemporains : le refus de la facilité. Refus plus éthique que technique, en l’espèce, puisque beaucoup de ses oeuvres pédagogiques, sans être particulièrement difficiles à jouer, ménagent presque toujours un élément de surprise, une modulation, un tour de phrase inattendus. Philippe Mouratoglou fait observer avec raison que ces trouvailles précieuses se rencontrent curieusement plus dans ses Etudes que dans les « grandes » oeuvres de concert « dans lesquelles se côtoient des passages très inspirés et des choses nettement plus conventionnelles ». Cela ne doit guère étonner de la part d’un homme qui a mis le meilleur de lui-même dans la transmission et dont les pièces didactiques, loin de constituer une activité annexe, furent une raison d’être.
Comme tout grand maître, Sor apprend en enseignant. Le propos technique qu’il veut illustrer par telle étude ou telle leçon se dissout dans l’évidence de la musicalité, et s’efface poliment derrière la primauté du chant. Même s’il n’a pas produit une grande quantité de musique vocale, on sait que Sor fut obsédé toute sa vie par le bel canto, passion que partagea également un instrumentiste-compositeur contemporain autrement célèbre, Frédéric Chopin. Eu égard à cette religion du chant comme modèle absolu d’esthétique instrumentale, il n’est pas exagéré de dire que les études de Sor, du moins les plus belles, sont à la guitare ce que celles de Chopin sont au piano : un postulat technique pour oublier la technique. Cette passion de la ligne vocale, lorsqu’elle est assouvie avec autant d’ardeur que chez Chopin ou Sor, offre à la structure harmonique une liberté nouvelle et c’est alors avec un naturel confondant que les modulations les plus hardies peuvent sonner avec la clarté lustrale des évidences. Sans aller aussi loin que Chopin dans le jeu qu’autorise l’enharmonie, Sor se distingue par sa faculté d’éclairer une même cellule mélodique par des harmonies différentes, ou de traiter une même mélodie successivement dans le mode majeur puis mineur. Evidemment, le goût du bel canto régnait alors en maître chez tous les musiciens et mélomanes mais Bernard Piris rappelle avec raison, dans sa précieuse monographie consacrée à Sor, en quoi cette passion de la vocalité a pu, aussi, stériliser l’inspiration des moins bons artistes et stimuler les meilleurs : « les mélodies italiennes sont, il est vrai, souvent belles et au moins séduisantes lorsqu’elles ne sont qu’habiles, et rendent le jeu de la guitare assez violonistique dans ses effets, mais il semble que cette exclusive du chant a pour inconvénient majeur de faire adapter la technique de composition aux contingences, aux idiomatismes de l’instrument. Giuliani, qui a laissé nombre de petites pièces et d’études ravissantes, équilibrées et très fines, qui est un grand mélodiste (…) ne donne qu’une oeuvre longue et ennuyeuse, d’un conventionnel tout en « ficelles » quand il écrit par exemple sa Grande Ouverture op. 61. (…) Sor, au contraire, s’accommode très bien d’un motif de notes répétées, qui serait insignifiant s’il n’était habillé d’une harmonie, ou valorisé par un contrepoint dont les secrets, alors, n’appartiennent qu’à lui. _ » Fernando Sor fut donc un homme de son temps 1 mais aussi, comme pour tous les artistes dont l’oeuvre traverse les époques, un marginal obstiné qui a préféré les redoutables plaisirs de la solitude aux peines du conformisme, fussent-elles plus immédiatement séduisantes pour ses confrères moins regardants. D’ailleurs, Sor n’a que peu cédé à la vogue du thème varié sur des airs d’opéra, à l’exception notable de son Opus 9, les Variations sur « O Cara Armonia » de Mozart, qui résument déjà toute son ingéniosité et témoignent d’une fascination si durable pour la Flûte enchantée qu’on a cru y voir l’indice probant d’une adhésion de Sor aux idéaux de la franc-maçonnerie qui ralliait alors bon nombre de ses pairs musiciens. Au-delà de ce point d’histoire, ces six pages, pas si primesautières qu’elles en ont l’air, concentrent tout le talent de leur auteur pour soumettre le prétexte technique au magistère de l’expressivité.
C’est la même exigence qui a guidé Philippe Mouratoglou dans la sélection des pièces qui composent ce programme : « Le choix du répertoire de ce disque ne résulte pas d'une volonté de "dénicher" des pièces peu jouées ou autres "chefs d'oeuvre inconnus" de Sor, mais plutôt de proposer une sélection de mes pièces favorites (qui sont d'ailleurs toutes — à l'exception du "Calme" — des oeuvres de jeunesse) et d'en pousser l'interprétation le plus loin possible. Mes références en la matière ne sont par ailleurs pas les guitaristes classiques "historiques" mais bien d'avantage des pianistes comme Sviatoslav Richter, Martha Argerich, Arturo Benedetti Michelangeli, Claudio Arrau… (même si j'apprécie dans Sor des interprètes comme Andres Segovia ou Roland Dyens - probablement d'avantage pour la singularité de leur empreinte sonore que pour des raisons purement interprétatives) ».
Pareillement, le choix d’interpréter ces oeuvres sur un instrument moderne, et non sur une guitare romantique, se justifie pleinement par la richesse de nuances et de résonances qu’il sait en tirer. Dans ses précieuses Histoires de peintures, Daniel Arasse notait que l’historien d’art ne doit pas craindre d’être anachronique, puisque l’art est toujours contemporain pour le contemporain qui le regarde_ 2. Il en va de même pour l’interprète qui, sans mésestimer les mérites d’une interprétation « historiquement informée » et le charme puissant des instruments d’époque, choisit néanmoins de jouer Fernando Sor, Benjamin Britten ou Toru Takemitsu sur le même instrument : l’enjeu est alors de savoir leur prêter des couleurs sonores, des articulations, des dynamiques différentes, toutes choses que permet la lutherie moderne, si tant est qu’elle soit au service d’une compréhension intime des musiques de chaque époque. L’omnipotent critique Fétis, qui multiplia les éloges doux-amers de Sor tout en regrettant que celui-ci s’exprime sur un instrument aussi ingrat et peu sonore que la guitare de son temps_3, rabattrait assurément son caquet en découvrant comment cette musique peut sonner sur un instrument moderne, joué par un interprète qui sait en exprimer les rémanences et la plénitude harmonique, en utilisant toute la palette de résonances qu’offre la technique moderne, y compris en matière de prise de son.
Car chez Fernando Sor, le silence importe autant que les notes : le détaché stroboscopique — mais pas sec, ni pizzicato!— de l’Etude op.31 n°20, la carrure ïambique de l’Etude op.35 n°17, si facile à ruiner en ignorant les demi-soupirs qui lui donnent sa prestance et son allant, ou les discrètes mais néanmoins indispensables respirations de la tumultueuse Etude op.6 n°9 toute baignée de son impérieux ré grave qui ne doit pas la noyer, sont autant de détails qui échappent souvent aux amateurs attirés par l’apparente facilité digitale de ces pages certes bienveillantes, mais certainement pas faciles.
Sa musique en surface séduisante et familière ressemble finalement à l’un des rares portraits qu’il nous reste de son auteur : il est saisi avec cette sorte de demi-sourire qui dit l’ironie sans méchanceté, le retrait engagé et la ferveur sans illusion de tous les artistes qui ont préféré, à leur corps pas trop défendant, la justesse à la grandeur. Et qui nous parlent encore, en proportion de cette folle sagesse.
Gilles Tordjman
Philippe Mouratoglou : guitare classique
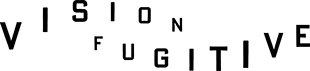

Revue de presse
26/04/2019Fernando Sor - Philippe Mouratoglou
Plus d'infos